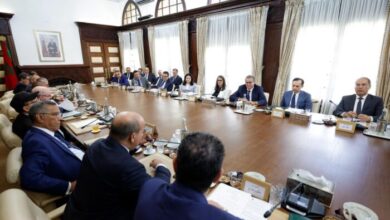Économie sociale et solidaire : un pilier essentiel pour une croissance inclusive et durable, selon Akhannouch.

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé aujourd’hui, mardi à Banjir, que l’économie sociale et solidaire joue un rôle majeur dans le renforcement du tissu économique national, contribuant en tant que pilier essentiel à l’atteinte d’un développement inclusif et durable, garantissant l’équité spatiale et sociale.
Lors de son intervention à l’ouverture des travaux de la cinquième édition de la conférence nationale sur l’économie sociale et solidaire, Akhannouch a souligné que « Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde une grande importance à ce secteur vital », mettant en avant le rôle de ce dernier dans l’entrepreneuriat et la transition de l’économie informelle vers l’économie organisée.
Il a poursuivi en indiquant que les coopératives, qui constituent l’un des fondements du secteur, connaissent une dynamique importante, avec plus de 61 000 coopératives regroupant près de 800 000 membres, ce qui révèle les potentialités prometteuses du secteur pour la création d’emplois et l’inclusion économique. Il a insisté sur le fait que ce secteur reflète les principes de solidarité et de coopération ancrés dans la société marocaine, précisant que ces valeurs ne sont pas seulement un héritage social, mais représentent également une base solide sur laquelle on peut construire un développement équitable et harmonieux, ouvrant de réelles perspectives d’inclusion économique et sociale pour diverses catégories.
Le Chef du gouvernement a appelé à exploiter et à développer ces atouts, en soutenant les capacités des coopératives et des entreprises sociales, notamment en ce qui concerne l’amélioration de la qualité et la commercialisation des produits locaux, tout en soulignant la nécessité de s’ouvrir aux marchés mondiaux et de renforcer la compétitivité, par la valorisation du capital humain et l’innovation dans ce domaine. Il a également rappelé que le gouvernement a fait du développement de l’économie sociale et solidaire une priorité, en œuvrant à la qualification du secteur et à la valorisation de ses ressources et potentialités, ce qui pourrait renforcer sa position en tant que levier de développement local et national.
Cette conférence, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se déroulera sur deux jours, par la Secrétariat d’État chargé de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique, et réunira des ministres, des responsables, des experts marocains et étrangers ainsi que plus de 1000 participants en provenance des continents africain, asiatique, latino-américain et européen.
Le programme de cette cinquième édition de la conférence comprend une série de séminaires, d’ateliers, de discussions thématiques et de masterclass animés par des membres du gouvernement, des responsables institutionnels, des acteurs de terrain ainsi que des experts et chercheurs nationaux et internationaux, dans le but d’étudier, de discuter et de valoriser les expériences et efforts accumulés par le Maroc, à la lumière des expériences internationales, ainsi que d’explorer les moyens par lesquels le projet de loi-cadre sur l’économie sociale et solidaire, ainsi que ses textes d’application, peuvent améliorer la gouvernance du secteur et offrir un environnement propice au développement de ses organisations.