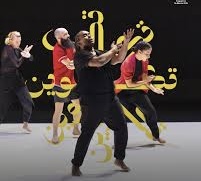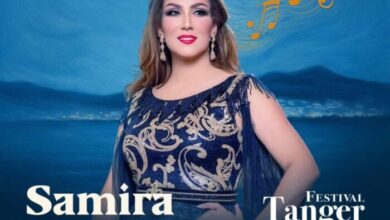L’identité marocaine entre nouveauté constitutionnelle et nécessité d’une nouvelle gouvernance de l’identité nationale

Par Khadija Elkour, chercheuse en sociologie et ancienne inspectrice générale au ministère de la Culture
La Constitution de 2011 a marqué un tournant décisif dans l’histoire du Maroc, en reconnaissant officiellement la pluralité des composantes et des sources de l’identité nationale. Pour la première fois, la Constitution stipule clairement que l’identité marocaine n’est pas unifiée au sens de l’enfermement, mais unifiée par la fusion de ses différentes composantes. Cette nouveauté constitutionnelle ouvre de nouvelles perspectives, mais pose également d’importants défis, car ces transformations exigent la détermination de nouvelles modalités de gouvernance de l’identité nationale, allant au-delà du symbolisme vers une gestion effective des appartenances et des sources au sein des politiques publiques.
Dans ce cadre, le préambule de la Constitution de 2011 affirme que l’identité nationale marocaine repose sur la fusion de ses composantes essentielles, à savoir : arabe, islamique, amazighe, et la culture sahraouie hassaniya, en plus d’une richesse de sources multiples comprenant l’africaine, l’andalouse, l’hébraïque et la méditerranéenne. Ce texte constitutionnel est une expression manifeste d’une volonté politique claire de reconnaître la pluralité des origines et des éléments culturels qui forment la personnalité marocaine.
La culture amazighe émerge comme un élément fondamental parmi les sources de l’identité nationale, et a reçu une reconnaissance constitutionnelle explicite en 2011, devenant une langue officielle aux côtés de la langue arabe. Cette reconnaissance n’était pas une fin en soi, mais plutôt une porte d’entrée vers des discussions plus profondes sur les mécanismes d’intégration effective de l’amazighe dans l’espace public, que ce soit dans l’éducation, les médias, ou les institutions et politiques culturelles, de manière à renforcer la pluralité au sein de l’unité.
De même, il est impossible de parler de l’identité marocaine dans sa dimension constitutionnelle sans évoquer l’élément sahraoui hassaniya, qui fait partie intégrante du tissu national, comme l’indique clairement le préambule, aux côtés des autres sources multiples. Cet élément représente plus qu’une simple diversité linguistique ou culturelle ; il porte un lourd passé historique et militant en lien avec le territoire et la population du Sahara marocain vis-à-vis de l’État et du trône depuis des siècles. Toutefois, l’intégration culturelle complète de cette composante reste en deçà des attentes, son expression se limitant souvent aux manifestations officielles ou folkloriques, sans obtenir une place significative dans les politiques publiques culturelles ou éducatives.
La diaspora marocaine à l’étranger, estimée à plus de six millions de Marocains, constitue également un champ vital dans la redéfinition de l’identité nationale, ayant développé des identités individuelles combinant les composantes amazighes et arabes, tout en s’ouvrant sur les cultures des sociétés où ils résident. De telles dynamiques soulèvent des questions importantes sur la manière d’intégrer ces expériences multiples et diverses dans le construct culturel national, ainsi que sur l’utilisation des médias numériques pour renforcer les liens culturels et spirituels avec la patrie, ce qui constitue à la fois un défi et une opportunité.
Dans ce même registre, les nouvelles générations de jeunes occupent une place centrale dans ce processus dynamique de construction d’une identité marocaine contemporaine. Les jeunes, nés à l’ère du numérique et des technologies modernes, ne sont plus seulement des consommateurs de contenus culturels; ils sont devenus des acteurs dans leur reconfiguration et leur développement. Cette génération porte une nouvelle vision du monde et s’implique dans une interaction continue avec son identité nationale à travers de vastes espaces numériques qui permettent l’expression, l’échange culturel, et la formulation d’une identité renouvelée en résonance avec les exigences du monde moderne. Il est donc essentiel que la culture de ces générations soit légitimement intégrée dans la stratégie nationale de la nouvelle gouvernance de l’identité, étant considérée comme une partie essentielle du tissu culturel national en évolution.
À la lumière de ces changements, il est impossible de négliger le rôle croissant des technologies numériques, qui constituent un outil essentiel pour reconfigurer la conscience identitaire, notamment chez les jeunes. Les espaces numériques ne sont plus de simples moyens de communication, mais des lieux dynamiques d’expression personnelle, d’interaction avec des symboles culturels, et de découverte de liens communs entre les différentes composantes de la société marocaine. D’où l’importance des politiques culturelles numériques dans la production d’un contenu diversifié qui reflète la richesse et la pluralité de l’identité nationale, renforçant le sentiment d’appartenance dans un environnement pluriel.
La diversité culturelle et linguistique que possède le Maroc est une richesse nationale qui doit être gérée avec une gouvernance éclairée et créative, garantissant la participation effective de toutes les composantes dans la décision culturelle, et reflétant l’équilibre entre les spécificités locales et la vision d’ensemble.
Dans ce contexte, il est essentiel de réécrire notre histoire culturelle sous un nouveau prisme, qui rend justice aux composantes fondamentales de l’identité marocaine, et qui, en premier lieu, intègre les récits africains, andalous, hébraïques et méditerranéens comme des éléments actifs dans la construction de la personnalité marocaine. Cette nouvelle écriture de l’histoire n’est pas simplement un exercice académique ; elle constitue une nécessité nationale pour transmettre une conscience collective partageable aux nouvelles générations, valorisant la pluralité, ancrant les valeurs de vie commune, et contribuant à bâtir une citoyenneté culturelle inclusive fondée sur la connaissance et l’appartenance.
D’autre part, il est impensable que la réécriture de l’histoire culturelle nationale puisse être complète sans reconnaître le rôle vital des femmes marocaines au fil des âges. La contribution des femmes à la construction de la civilisation marocaine et à l’enrichissement de l’identité nationale n’a pas été marginale ou secondaire, mais a constitué un élément agissant et central dans la formation de la mémoire collective ainsi que des valeurs culturelles et sociales. Par conséquent, le processus de réécriture historique doit mettre en lumière les rôles féminins et intégrer leurs réalisations et contributions dans le récit national, en les considérant comme des partenaires à part entière dans la fabrication d’une identité marocaine commune et plurielle.
S’engager dans une nouvelle gouvernance de l’identité nationale n’est plus une option, mais une nécessité pour bâtir un Maroc ouvert, démocratique et uni dans sa pluralité. Une gouvernance qui redonne dignité à chaque composant et oriente les politiques culturelles, éducatives et médiatiques vers une construction nationale commune qui écoute toutes les voix et rédige collectivement son récit avec responsabilité.